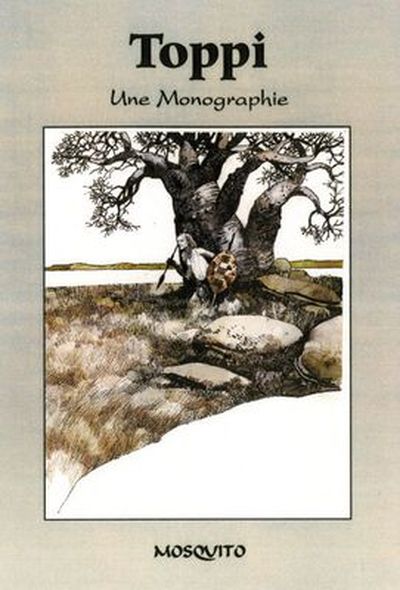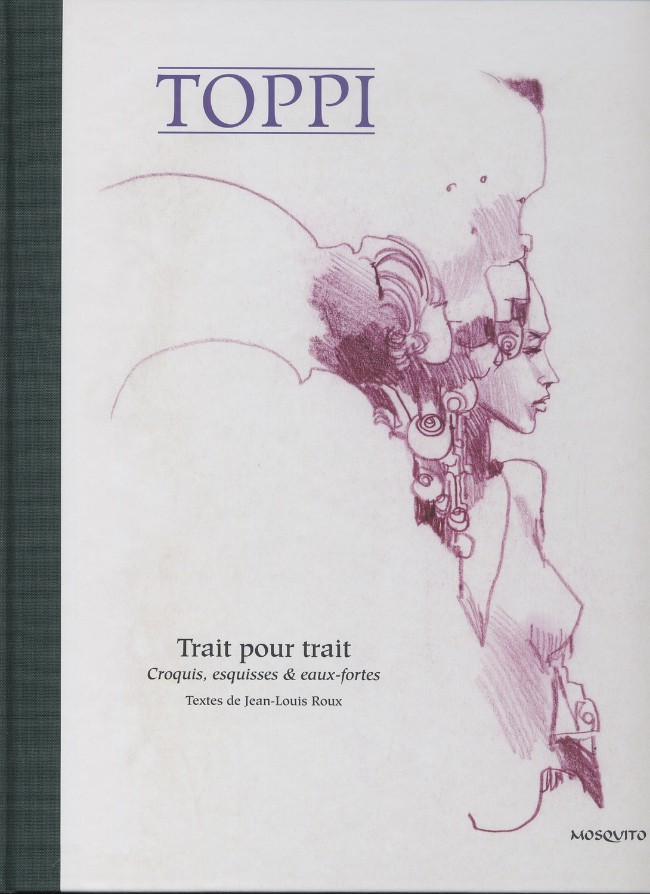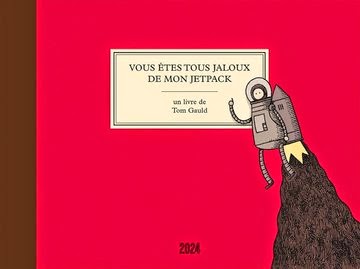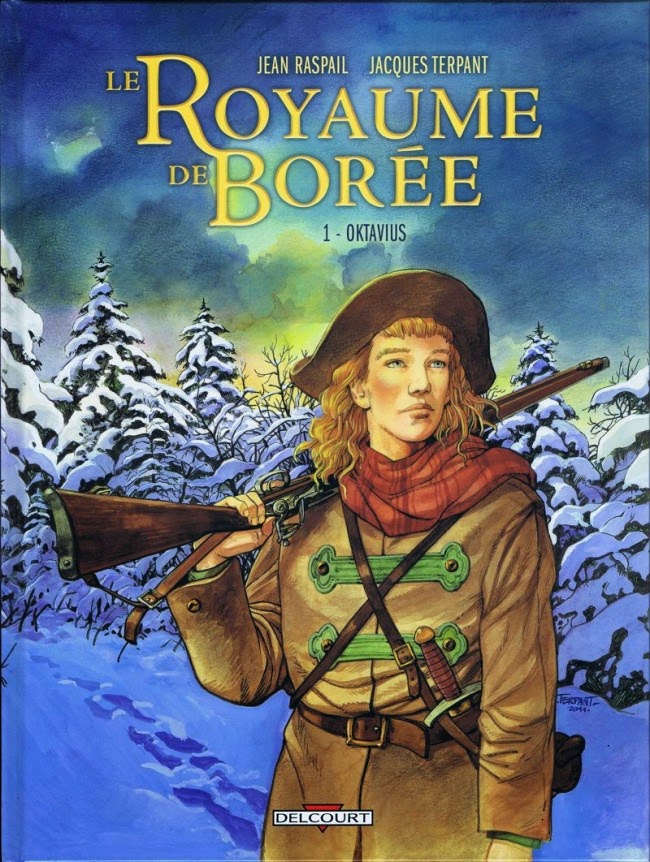Topor dessinateur de presse. - Les cahiers dessinés, 2014.
Du temps que les dessinateurs mouraient de leur belle mort, Roland Topor régnait en roi débonnaire sur une forêt de plumes et de crayons, traversée d'un rire qui s'entendait de loin. Et se voyait d'encore plus loin tant son trait, acéré, griffé, hachuré, reconnaissable entre tous, avait le don de crever la page. Travailleur acharné comme tous les grands paresseux et constamment sollicité, Topor s'est commis dans d'innombrables journaux, d'innombrables revues à travers le monde, de toute nature et de toutes obédiences. De Hara-Kiri (première manière) au New Yorker (qui le jugeait bien un brin trop "surréaliste" pour son lectorat), Topor avait toujours sous le bras quelque dessin à donner, quelque chronique à tenir, quelque vision à coucher sur le papier pas toujours glacé d'une presse infiniment vivante, mouvante, éphémère parfois, mais qu'une couverture de Topor rendait toujours mémorable. Celui qui ne se voulait pourtant pas dessinateur de presse mais "dessinateur dans la presse" reste paradoxalement l'une des signatures les plus vues dans les journaux, du début des années 60 à la fin des années 90, comme en témoigne cette belle et nourrissante compilation où l'on ne manquera pas de reconnaître au fil des pages tel dessin que l'on croyait avoir oublié, tel que l'on avait toujours connu et d'autres, plus étranges encore, que l'on découvre avec la troublante impression de les avoir déjà vus quelque part, en rêve sans doute, dans l'un ou l'autre de nos cauchemars, tramé de la même encre. Car le cauchemar est à la source de l'art de Topor, source noire née du souvenir d'une enfance traquée, qui lui laissera une angoisse durable et qui s'incarne véritablement dans les innombrables et incessantes métamorphoses de corps toujours susceptibles de surprenantes déconfitures dont, chose encore plus surprenante, aucune n'a mal vieilli. C'est que Topor, n'étant pas caricaturiste, ne se sentait pas tenu par une actualité qui l'ennuyait et dont la péremption plus ou moins véloce entraîne avec elle tant de dessins de presse. Son sujet, c'est bel et bien l'homme, avec ou sans chapeau mais toujours lesté de ses matières, la merde en tête, au propre comme au figuré. Cette merde qui est à l'homme de Topor ce que le rire est à celui de Bergson : un "propre" à peine un peu plus sale que l'autre, en tout cas d'une indéniable franchise et qui constitue l'essentiel de la couche nutritive où prend naissance, affleure, éclot et se délite l'intemporelle humanité du dessinateur. La même, au fond, que celle qui s'agitait dans les visions les plus torturées d'un Odilon Redon, d'un Alfred Kubin ou de ce Bruno Schulz dont Topor partageait les origines juives et polonaises et une certaine veine, parcourue du même sang noir de l'absurde.
Entrecoupé d'entretiens bien venus avec Poussin, Picha et Willem et préfacé par Jacques Vallet, fondateur de l'irremplaçable revue
Le fou parle (1977-1984), taillé au cordeau par les toujours impeccables Cahiers dessinés *, ce beau gros pavé ravira évidemment les bien-pensants et djihadistes de tout poil de barbe, qui se feront un plaisir de le prendre en travers de la gueule, de la part de tous ceux qui n'ont toujours pas peur de rire (un peu jaune, il faut tout de même bien l'avouer).
Topor Strips paniques. - Wombat, 2014.
Sans être un touche-à-tout, Topor ne se refusait rien. Dessin, littérature, cinéma, chanson, théâtre, télévision... peu de domaines artistiques qu'il n'ait abordé, à part peut-être (sait-on ?) la sculpture sur saindoux. En tout cas, la bande dessinée ne lui a pas échappé, même si ce fut toujours de façon marginale. Pour le troisième titre de leur collection
Les iconoclastes, les éditions Wombat ont eu la bonne idée de réunir ces différentes tentatives, devenues pour la plupart introuvables et qui, si elles n'offrent pas de révélations fracassantes quant aux destinées du 9e art, n'en donnent pas moins un aperçu intéressant du génie propre de l'artiste, habité d'une inquiétude qu'il est en effet légitime de résumer sous le titre de "panique" **. Privilégiant la forme ancienne de l'histoire en images, les récits de Topor, d'une abjection parfaitement jubilatoire, profitent de ce contraste entre un graphisme difficilement datable et un contenu d'une violence et d'une noirceur résolument modernes qu'une seule image suffirait peut-être à résumer : une mère s'apprêtant à revolvériser son bébé en lui criant "Crève !"
* dont on en profite pour signaler la très belle exposition rétrospective (et prospective) à la Halle Saint-Pierre à Paris, jusqu'au 14 août 2015.
** du nom de ce mouvement à géométrie variable que formèrent Topor, Arrabal, Jodorowsky et quelques autres, que rebutait le Surréalisme papal d'André Breton.