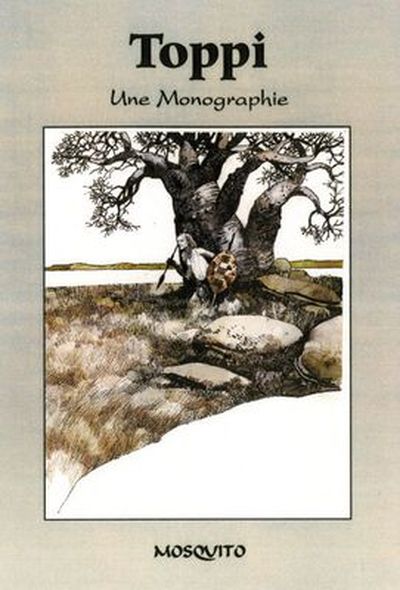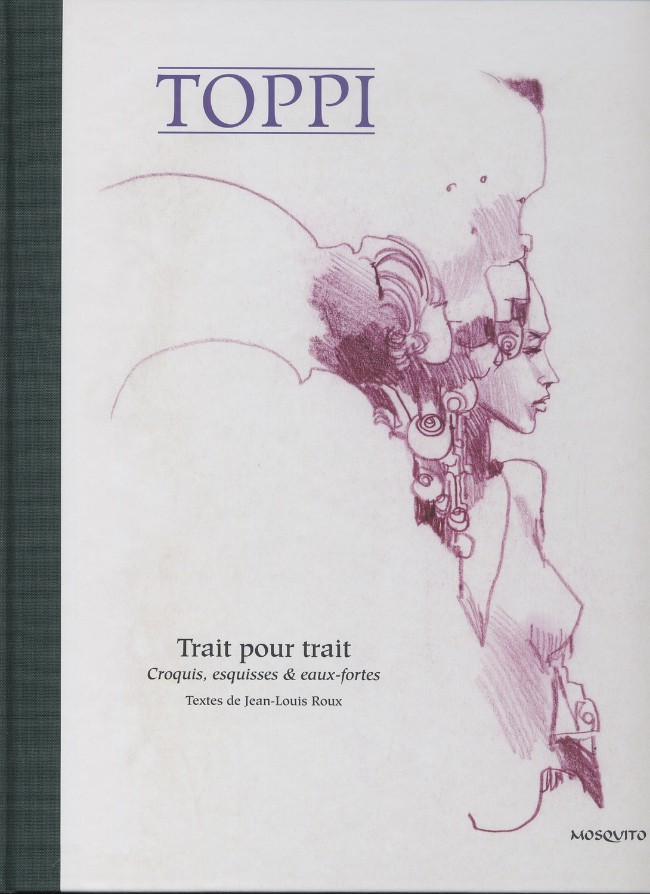J’ai vu passer le bobsleigh de nuit / Gébé. – Les cahiers
dessinés, 2014.
Gébé est mort en 2004. Dix ans plus tard, on ne s’en est pas
encore remis, au point qu’il faille de temps en temps rééditer ses livres, tout
simplement parce qu’on n’a pas trouvé mieux. Qui, mieux que lui, aura jamais su
questionner les évidences, même les mieux ancrées, bousculer les certitudes et les
ça va de soi pour les envoyer bouler dans l’escalier ? Qui aura jamais eu
comme lui l’art, non pas de la dérision (d’autres font ça très bien) mais du
simple pas de côté, celui qui fait considérer autrement les gens et les
choses ? Pour être entré à Hara Kiri en 1961, dès les débuts du journal,
son humour ne fut jamais ni si bête, ni si méchant, mais profondément
différent, indéfinissable, comme un art de pousser les situations dans leur
dernier retranchement, jusqu’à l’absurde. On n’est jamais, avec lui, dans le
registre du gag : ses histoires n’ont pas de chute, elles s’arrêtent,
simplement, quand il a développé son idée, comme une plante cesse de grandir. Il
y a du bricoleur, chez Gébé, une manière ingénieuse et empirique d’envisager le
monde et la vie qui fait de lui le dessinateur le plus aristocratiquement
prolétaire de la bande dessinée, au sens où l’on parlait autrefois d’une
aristocratie du travail. On l’imagine aimant les constructions, les machines et
les machins, tous ces trucs et ces bidules qui traînent au fond des remises et
des tiroirs, parce qu’on ne sait jamais, ça peut servir un jour. C’était
peut-être le destin des pages recueillies dans ce volume, qui semblent de
provenances et d’époques assez diverses (les références ne sont pas données, c’est
le seul reproche que l’on fera à cette édition pour le reste impeccable, comme
toujours avec Les Cahiers dessinés). Elles n’en sont pas moins précieuses à
tout un tas de titres, qui montrent Gébé au sommet de son art, dans ce registre
qui lui est propre, à la fois poétique et politique au sens le plus noble du
terme, où l’on s’en va faire un tour avec le bobsleigh de nuit en attendant de
grandir et d’oublier, où l’on téléphone au fond d’une théière, où l’on est
filmé pendant les quarante premières années de sa vie pour passer les quarante
suivantes à regarder le film, où l’âme, désormais, doit s’abaisser à renouer
les lacets.
Je ne sais pas où traîne à présent celle de Georges Blondeau.
Peut-être s’est-elle changée en comète – qui sait ? et ensemence-t-elle à
présent des planètes comme lui-même sut si bien ensemencer la pulpe de bois. Celui
dont on fait les rêves, évidemment.