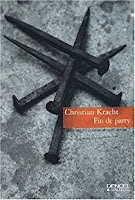Il n’en revint que trois, de
Guðbergur Bergsson. - Métailié,2018
On n'est jamais tranquille. Oubliée de tous sauf de Pierre Loti, l'Islande coule des jours paisibles quand la guerre, soudain, vient lui donner une importance stratégique insoupçonnée. Les Américains en font une base avancée et déversent sur elle l'habituelle flopée de cochonneries qui font les trente glorieuses. L'Islande profite, elle devient grasse et se laisse aller à son avidité latente. Voilà pour résumer le propos sous-jacent du dernier récit de Guðbergur Bergsson, 85 ans aux prunes et donc témoin direct de la métamorphose. Le Gamin, ce pourrait être lui, invité sporadique d'une ferme isolée dont il finira par hériter pour en faire un hôtel de luxe, à l'image d'un pays gagné tout entier par la cupidité. Réceptacles involontaires d'une histoire qui leur parvient par bribes, ses habitants ne sont néanmoins pas des victimes : nulle nostalgie pour un quelconque ordre ancien chez Bergsson, dont le regard affûté n'épargne pas plus ses compatriotes que ses visiteurs maladroitement intrusifs. La simplicité rustique que leur prêtent deux jeunes Britanniques enthousiastes, la Vieille femme et son mari, les deux Gamines ou bien le Fils chasseur de renard n'en font pas vertu et la jettent allègrement aux orties contre un emploi subalterne chez les Américains ou le privilège de fouiller leurs décharges. De même, pour de l'argent, trahit-on sans trop de scrupules l'Allemand que l'on cachait pour rien. Cet esprit de lucre, il appartiendra à un étranger de passage de le déceler au cœur même des sagas qui fondent la culture islandaise et pour lesquelles il n'est nul crime qui ne puisse faire l'objet de compensations financières selon une conception éminemment négociable de l'honneur. Pour être compensée par un ton plutôt bonhomme, la charge n'en est pas moins cruelle, et l'on se demande comment le livre fut reçu dans son pays d'origine, auquel l'auteur renvoie volontiers l'image d'un vieillard incontinent, éternellement vautré sur le canapé du salon.
Moi, je serais l'Islande, ça m'aurait pas plu.
[texte paru dans Le Matricule des anges]